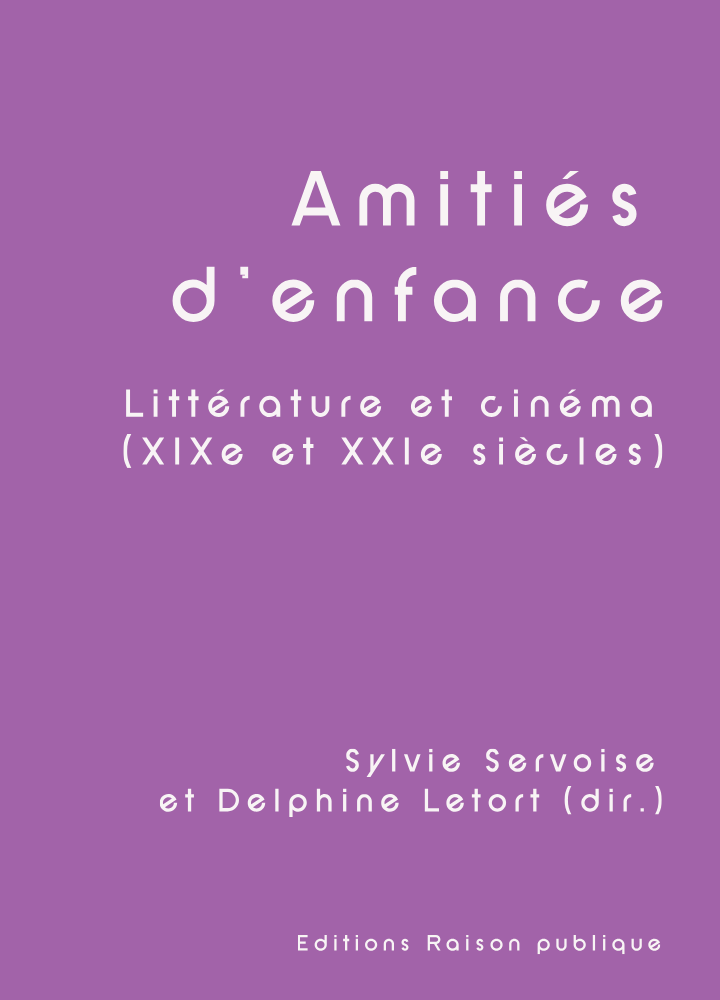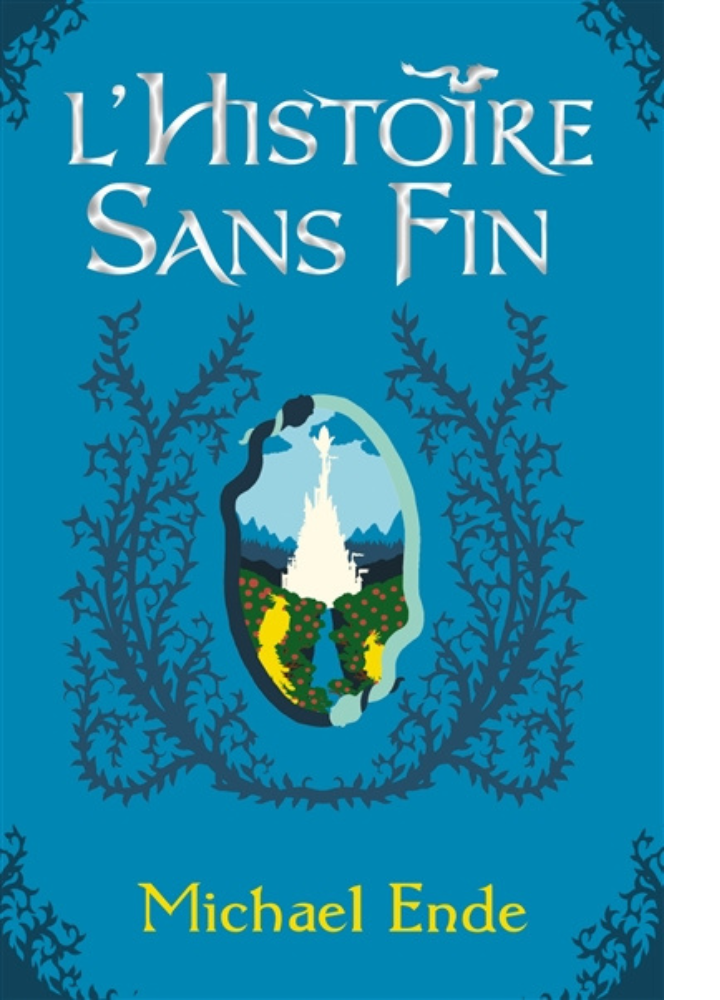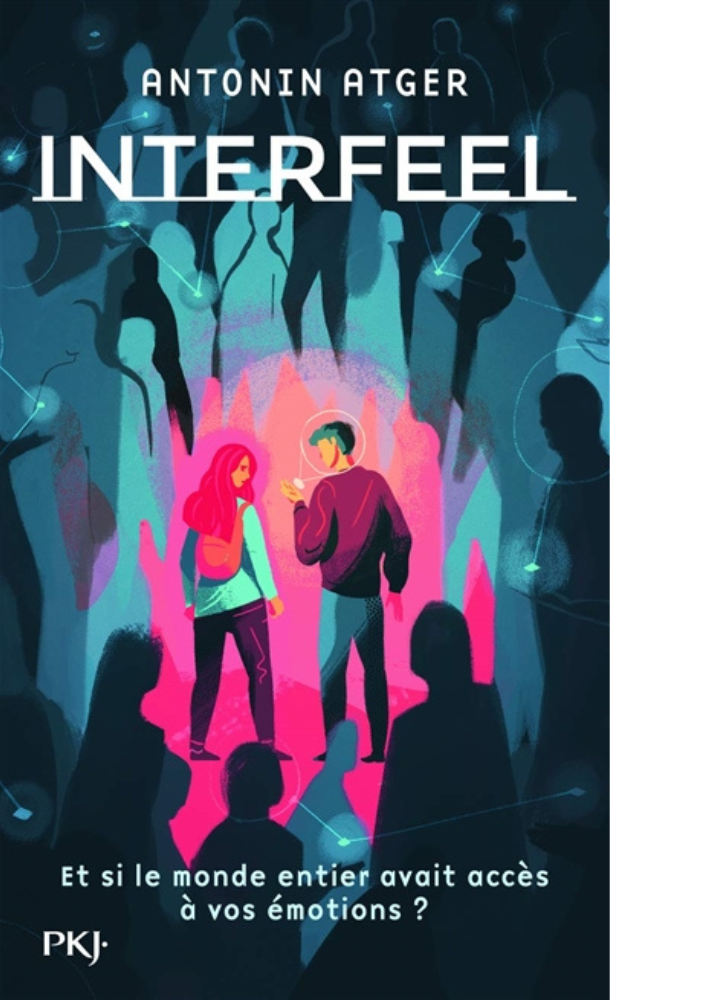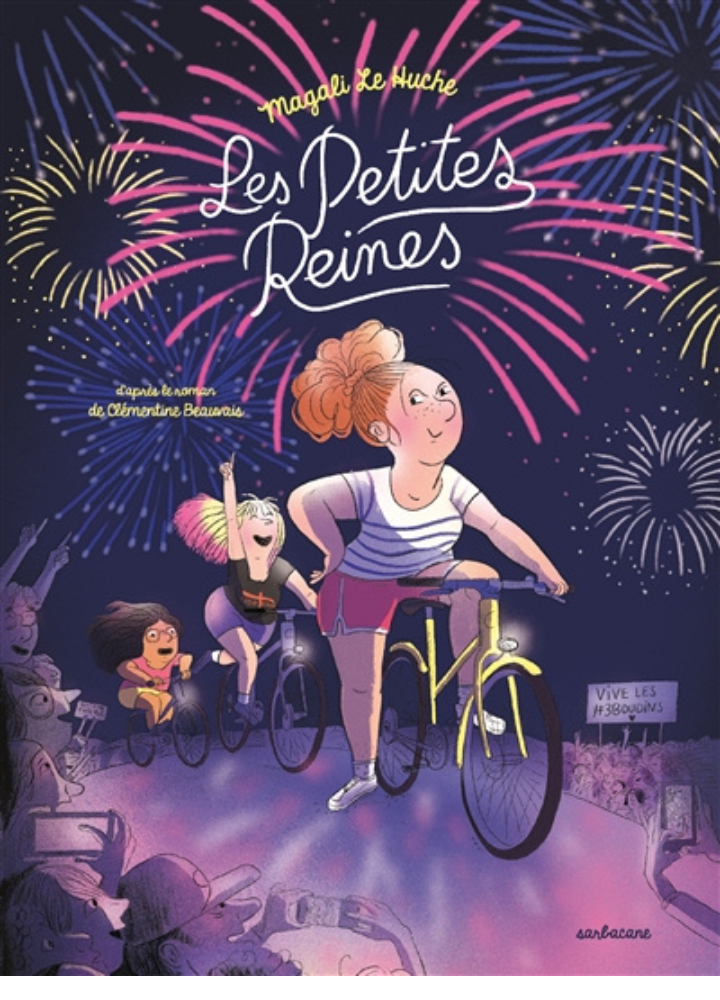Amitiés d’enfance et de jeunesse
Sylvie Servoise
Professeure de littérature à l’université du Mans
À l’occasion de la parution de l’ouvrage collectif Amitiés d’enfance (Éditions Raison Publique, 2025), Sylvie Servoise, qui a coordonné le livre avec Delphine Letort, revient sur l’importance des relations amicales dans la vie des enfants et des adolescents et les nombreuses représentations de celles-ci dans la production littéraire et cinématographique.
« Moi, je catalogue ma vie par amis. Chaque période a été dominée par la figure d’un ami », affirmait le cinéaste Jean Renoir. Manière de dire que l’amitié non seulement constitue une dimension primordiale de notre existence, mais encore qu’elle nous accompagne à tous les âges, en même temps qu’elle raconte, à sa manière, notre histoire : les amis que l’on quitte, les nouvelles amitiés que l’on noue représentent souvent des étapes majeures dans la trajectoire d’une vie. Il existe pourtant certaines amitiés dont on s’accorde à penser qu’elles jouent un rôle encore plus important que d’autres, parce qu’elles laisseraient une trace durable et constitueraient une expérience fondatrice : les amitiés d’enfance et de jeunesse.
Ce sont ces amitiés nouées à l’âge dit « tendre », mais qui peuvent être aussi douloureuses, qui sont au cœur de l’ouvrage collectif Amitiés d’enfance, Littérature et cinéma (XIX-XXIe siècle) que j’ai eu le plaisir de coordonner avec Delphine Letort, enseignante-chercheuse en études filmiques et américaines à Le Mans-Université. S’ouvrant sur la figure de l’ami imaginaire nécessaire au tout-petit et s’achevant sur cet autre ami virtuel qu’est le personnage de roman, l’ouvrage propose de parcourir les multiples chemins de l’amitié d’enfance et de jeunesse, aussi bien celle qui se noue entre les personnages de la fiction qu’entre ceux-ci et l’enfant-lecteur ou spectateur. Quatre étapes jalonnent cette exploration, menée par des chercheurs et chercheuses provenant aussi bien des études littéraires, cinématographiques, que de la psychanalyse, et qui s’appuient sur des œuvres tantôt spécifiquement dédiées à la jeunesse, tantôt sur des œuvres tout public mettant en scène des amitiés de jeunesse : les valeurs de l’amitié ; les genres de l’amitié ; les amitiés féminines et les amitiés virtuelles.
Notre postulat de départ était simple : les amitiés d’enfance et de jeunesse constituent un thème, littéraire et cinématographique, souvent exploré, manié et remanié au point de devenir un topos, un lieu commun ou passage obligé. On ne compte plus le nombre d’ouvrages et de films, plus particulièrement destinés à la jeunesse ou mettant en scène des personnages jeunes, qui ont pour titre le nom de l’ami des protagonistes, d’un couple ou d’un groupe d’amis : Mon ami Frédéric de Hans Peter Richter, Ernest et Célestine, de Gabrielle Vincent, le célèbre Club des Cinq d’Enid Blyton, ou encore, du côté du cinéma, Bandes de filles de Céline Sciamma… Dès lors, nous nous sommes demandé de quels enjeux et de quelles valeurs ces amitiés sont porteuses (et peut-être spécifiquement porteuses, par opposition aux amitiés nouées à l’âge adulte), et comment elles ont pu, depuis le XIXe siècle, c’est-à-dire au moment où s’épanouit une littérature destinée à la jeunesse, donner lieu à des représentations qui ont nourri l’imaginaire collectif. Un autre questionnement, ou plutôt une autre intuition, nous a guidées : dans quelle mesure les amitiés d’enfance, parce qu’elles sont premières, peuvent nous éclairer sur la complexité de l’amitié elle-même ?
Le mystère de l’amitié
C’est un fait : l’amitié est un mystère. Tout le monde semble savoir plus ou moins ce qu’elle signifie, pour en faire et en avoir fait l’expérience directe, mais peine à la définir, tant paraissent poreuses les frontières avec d’autres types de relations humaines (à commencer par l’amour et la camaraderie) et épineuses les questions qu’elle soulève : que cherche-t-on chez l’ami ou l’amie, un miroir de soi ou un autre que soi ? C’est toute l’ambivalence de la notion, essentielle, d’alter ego, à la fois « autre moi » et « autre que moi ». L’amitié, que l’on présente souvent comme la rencontre élective entre deux êtres (« parce que c’était lui, parce que c’était moi… » pour reprendre la célère citation de Montaigne évoquant son amitié avec La Boétie) est-elle forcément exclusive ? Inversement, la multiplication des amis est-elle nécessairement à comprendre comme un affadissement du lien amical ? Et d’ailleurs, pourquoi chercher et cultiver l’amitié : s’épancher, s’étendre hors de soi, ou au contraire trouver celui ou celle qui vous comprendra, dans une logique de repli et de séparation d’avec le monde ? Est-ce que l’amitié vise à assouvir certains de nos désirs ou besoins ou, au contraire, peut-on l’appréhender, à l’instar d’Aristote (Éthique à Nicomaque), comme une vertu fondamentalement altruiste, tournée vers le bien de l’ami ou l’amie ? On pourrait multiplier à l’envi ces questions, qui non seulement sont connues depuis longtemps – il suffit de songer à la longue tradition philosophique relative à la philia grecque et l’amitia latine – mais qui font encore l’objet d’un regain d’intérêt depuis une vingtaine d’années, et tout particulièrement dans le champ des sciences humaines et sociales : philosophes, sociologues, psychanalystes, historiens, anthropologues, s’attachent à cerner les contours d’une notion qui est tout à la fois un concept philosophique, un sentiment, une valeur, mais aussi, et cela vaut la peine d’être souligné, une pratique sociale, dont l’importance pour la construction psychique et l’intégration sociale de l’individu est de plus en plus étudiée, notamment en ce qui concerne les plus jeunes.
Amitiés d’enfance, dans les livres et dans la vie
Essentielle au développement cognitif et affectif de l’enfant, l’amitié constitue une étape fondamentale de l’apprentissage de la vie en société, au-delà du cercle familial. Intensément exclusives, ou au contraire plurielles, quand les amis et amies se retrouvent en « bandes » (de filles, de garçons ou mixtes) s’inscrivant dans le temps long ou au contraire singulièrement instables, ces amitiés ont sans aucun doute leurs spécificités, liées à l’âge de celles et ceux qu’elle engage, au contexte social où elles s’inscrivent, aux codes et rites qu’elles proposent. Si elles peuvent faire l’objet de représentations idéalisées, renvoyant au « vert paradis des amours enfantines » (Baudelaire), si l’on peut éprouver de la nostalgie à leur égard, comme on en éprouve pour de l’enfance, « pays perdu » à jamais (Roland Barthes), on peut aussi ne pas regretter la vulnérabilité d’un âge exposé aux « mauvaises fréquentations » qui laissent parfois des traces profondes. Assurément spécifiques, ces amitiés ne sont cependant pas pour autant délivrées des tensions qui traversent toute relation amicale et dont il a été fait mention plus haut : la question de l’exclusivité ; du rapport à l’ami ou l’amie comme autre soi ou autre que soi ; du désintéressement ou de l’utilitarisme…
Nombreux sont d’ailleurs les livres pour la jeunesse qui montrent la complexité des relations amicales, notamment celles vécues durant cette période de bouleversement intense qu’est l’adolescence : on pense à l’amitié qui rassemble le trio composé par Harry, Ron et Hermione dans Harry Potter, et qui, à mesure que les personnages grandissent, ressemble de moins en moins à un long fleuve tranquille. Annie Rolland, dans l’article qu’elle a écrit pour le volume Amitiés d’enfance, et où elle évoque ces classiques que sont le roman de J.K. Rowling mais aussi Le Seigneur des anneaux de J.R.R Tolkien, souligne que la littérature de jeunesse constitue un lieu privilégié où s’effectue, pour les lecteurs comme pour les personnages, le « voyage d’ego en altérité », un voyage initiatique tout à la fois réel et imaginaire.
En effet, on ne saurait oublier que le personnage de roman peut aussi constituer, pour le jeune lecteur, une espèce d’ami. En ce sens, l’expérience de l’amitié, de ses joies et de ses peines, peut s’avérer double, et doublement enrichissante, car elle se situe à deux niveaux : d’abord, au sein de l’univers fictionnel, entre les personnages (c’est l’amitié, apparemment inégalitaire, mais indéfectible, entre Sam et Frodon dans Le Seigneur des anneaux ; l’amitié entre Will et Lyra qui se transformera en un amour puissant dans À la croisée de mondes de Philip Pullman) ; ensuite, hors du monde fictionnel, entre le jeune lecteur et cet ami « virtuel » qu’est le personnage, pour reprendre le terme qu’emploie Daniel Delbrassine dans sa contribution au volume, consacrée précisément aux stratégies par lesquelles les auteurs jeunesse parviennent à créer un rapport intime entre personnages et lecteurs. Sur ces deux aspects, il me semble que L’Histoire sans fin, de Michael Ende, est assurément exemplaire : Bastien, jeune garçon mal dans sa peau, lit avec passion les aventures de l’intrépide Atréyu, dont il rêverait de devenir l’ami, jusqu’au moment d’entrer, par magie, dans le livre même qu’il lit et de fouler la terre de ce Pays fantastique qui le fascine. Il rencontre alors Atréyu, et c’est une amitié finalement difficile qui se noue entre l’ancien lecteur devenu personnage et le personnage devenu palpable. Quant au vrai lecteur, celui qui reste au seuil du Pays fantastique, il s’interroge : une amitié, qui semblait aussi forte que celle entre Bastien et Atréyu, et à laquelle il a pu aspirer lui-même (notamment parce qu’il est invité à s’identifier au lecteur Bastien) peut-elle prendre fin ? Peut-on changer au point de n’être plus reconnaissable aux yeux de nos amis, ou de ne plus trouver en eux ces alter ego qui nous rassuraient tant, non pas forcément parce qu’ils nous ressemblaient, mais parce qu’ils nous donnaient la force d’être pleinement nous-même, ou mieux que nous-mêmes ?
Sans doute, c’est une des grandes forces de la littérature que de donner à vivre aux lecteurs, de manière sensible, ces grandes questions. Les œuvres qui mettent en scène l’amitié nous invitent, en proposant des histoires qui correspondent à autant de trajectoires et combinaisons amicales possibles, à revenir en nous-mêmes pour chercher ce que nous demandons à l’amitié, à nos amis et ce que nous en attendons. Cependant, au-delà de ces interrogations essentielles et pour ainsi dire intemporelles sur ce que peut être l’amitié, et plus précisément l’amitié d’enfance et de jeunesse, c’est aussi une appréhension plus historique de ces notions que nous avons recherchée, en mettant l’accent sur deux aspects à laquelle notre époque se révèle particulièrement sensible : les amitiés virtuelles, via les réseaux sociaux ou avec des non-humains, et les amitiés genrées, qui s’inscrivent dans un certain nombre de normes et de conventions.
Amitiés d’aujourd’hui
Aux complexités des rapports avec les amis que l’on se fait à l’école, au club de sport ou en bas de chez soi, s’ajoutent en effet celles des amitiés « virtuelles », mais aux effets parfois bien réels, favorisées par les réseaux sociaux. De nouvelles pratiques, de nouveaux modes d’être ensemble se font jour depuis les années 2000, dont plusieurs productions à destination de la jeunesse interrogent la portée. L’article d’Irène Cacopardi, consacré au film d’animation pour enfants Rob débloque explore ainsi la relation d’amitié qui se développe entre le jeune Bernay et un B-bot, personnage objet connecté défaillant qui représente la différence dans le récit. L’autrice montre comment le film interroge l’usage de la technologie dans la construction de soi et dans le rapport à l’autre, en questionnant l’impact que ces technologies peuvent avoir sur les dynamiques socio-communicationnelles et sur les relations sociales des nouvelles générations. Les nouvelles technologies bouleversent indéniablement les pratiques de l’amitié, comme le souligne également Nadège Langbour qui s’intéresse à Interfeel d’Antonin Atger, une trilogie dystopique qui invente un monde où les amitiés sont déterminées par des algorithmes. Se voit ainsi soulevée une question majeure à l’heure où les réseaux sociaux confondent « followers » et « amis » : les jeunes protagonistes des romans ont-ils librement choisi d’être amis ou ont-ils été conditionnés et manipulés pour l’être ?
Si la grammaire de l’amitié virtuelle reste encore à décoder, en revanche l’amitié masculine, l’amitié féminine et l’amitié inter-genres s’inscrit dans un ensemble de normes et de conventions anciennes, que la littérature, comme le cinéma, convoque sans cesse pour le conforter, l’interroger ou le subvertir. Notre époque contemporaine est sans doute plus particulièrement attentive à la question du genre, et notre volume porte la trace de cette réorientation du regard. Plusieurs articles mettent l’accent sur la manière dont certains auteurs et autrices pour la jeunesse, du XIXe à nos jours, voient dans les amitiés d’enfance l’occasion de renforcer une répartition des rôles inégalitaire par genres, ou au contraire les associent à un espace de liberté, voire de subversion des stéréotypes masculins et féminins. La part belle est également faite aux amitiés féminines de jeunesse, longtemps laissées dans l’ombre du paradigme masculin de l’amitié (Oreste et Pylade, Les Trois Mousquetaires…) et qui sont au cœur de nombreux récits de la deuxième moitié du XXe siècle à nos jours, pas forcément à destination de la jeunesse du reste : Zaza et Simone de Beauvoir dans Mémoires d’une jeune fille rangée, Elena et Lila dans L’Amie prodigieuse d’Elena Ferrante. On pourrait ajouter que toute une littérature pour la jeunesse, à commencer par le célèbre Les Petites Reines de Clémentine Beauvais, met à l’honneur ces relations amicales entre filles, et suggèrent, de manière plus ou moins explicite, que c’est par la médiation de l’amie que les filles prennent conscience d’elles-mêmes et que l’émancipation est toujours une affaire collective.
Au terme, provisoire bien sûr, de cette exploration dans le vaste champ des amitiés d’enfance et de jeunesse, il n’est pas certain que nous soyons parvenus à dissiper le mystère de l’amitié, ce « je ne sais-quoi » qui a fait vibrer nos cœurs d’enfants et d’adolescents. Mais peut-être ne faut-il le déplorer, si cela nous incite, petits et grands, à lire davantage pour faire de nouvelles rencontres avec ces amis de papier que sont les personnages de fictions… et d’autres amateurs et amatrices de littérature qui partagent nos goûts. Ce pourrait même être le sujet d’un nouveau livre : non plus l’amitié dans les livres, mais l’amitié par les livres… Affaire à suivre, donc !
Sylvie Servoise et Delphine Letort (dir.), Amitiés d’enfance. Littérature et cinéma (XIXe-XXIe), Paris, Éditions Raison Publique, à paraître d’abord sur Cairn (https://shs.cairn.info/) puis disponible en librairie en mars.