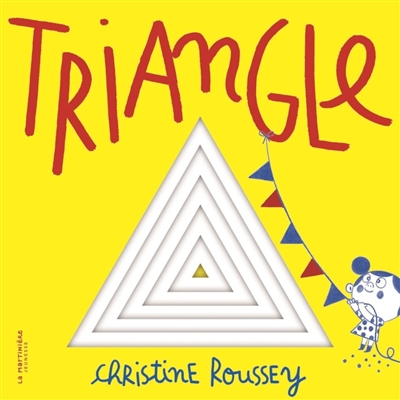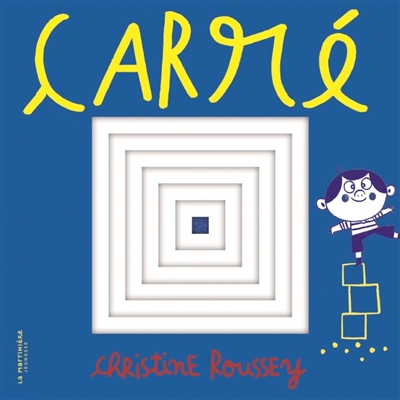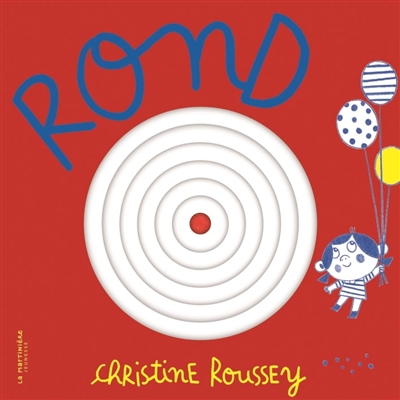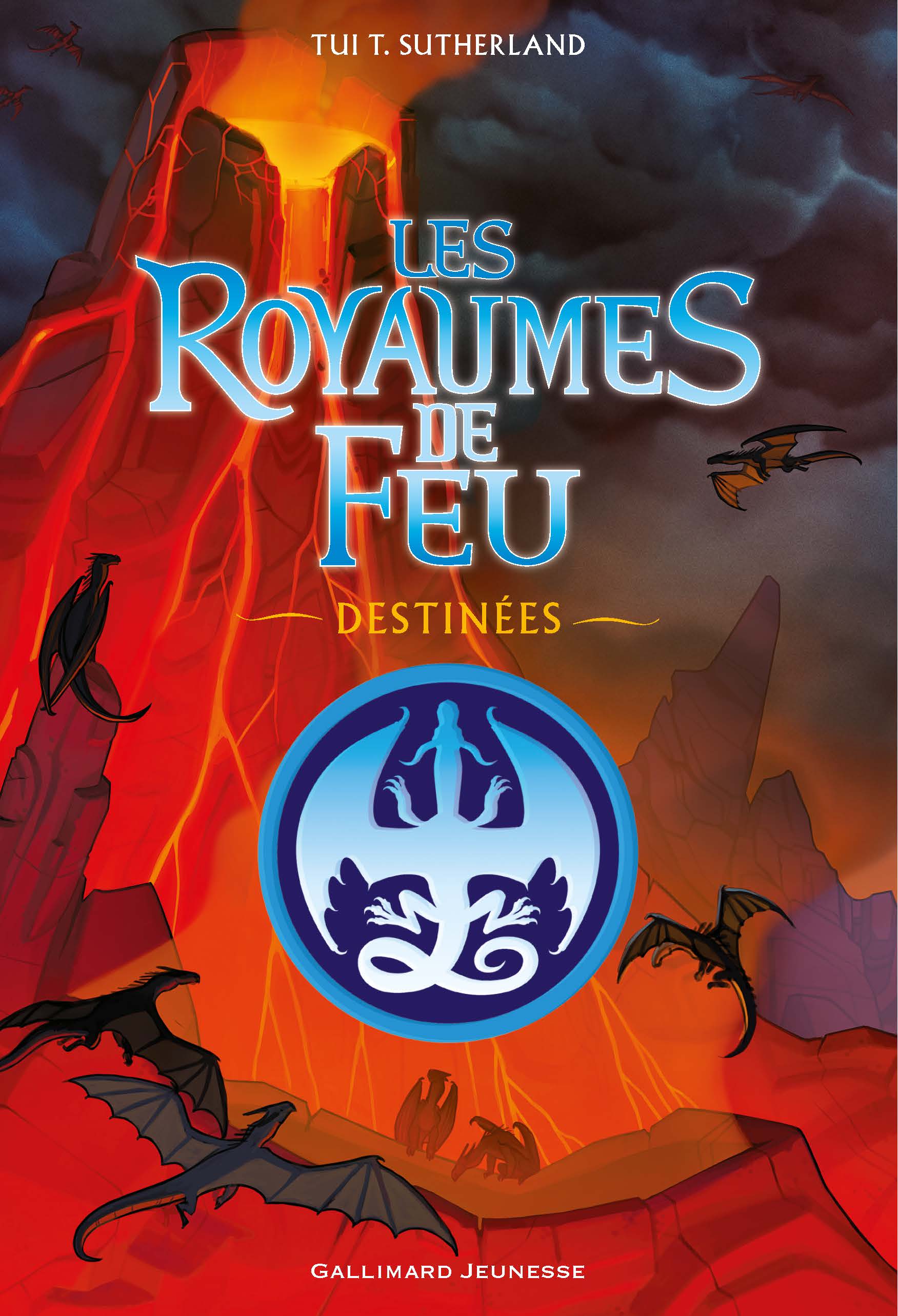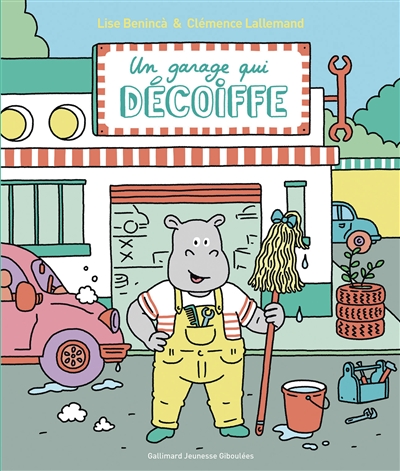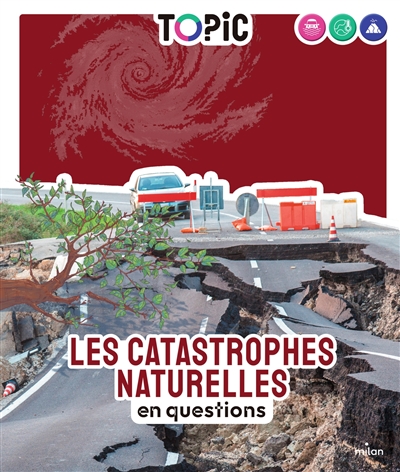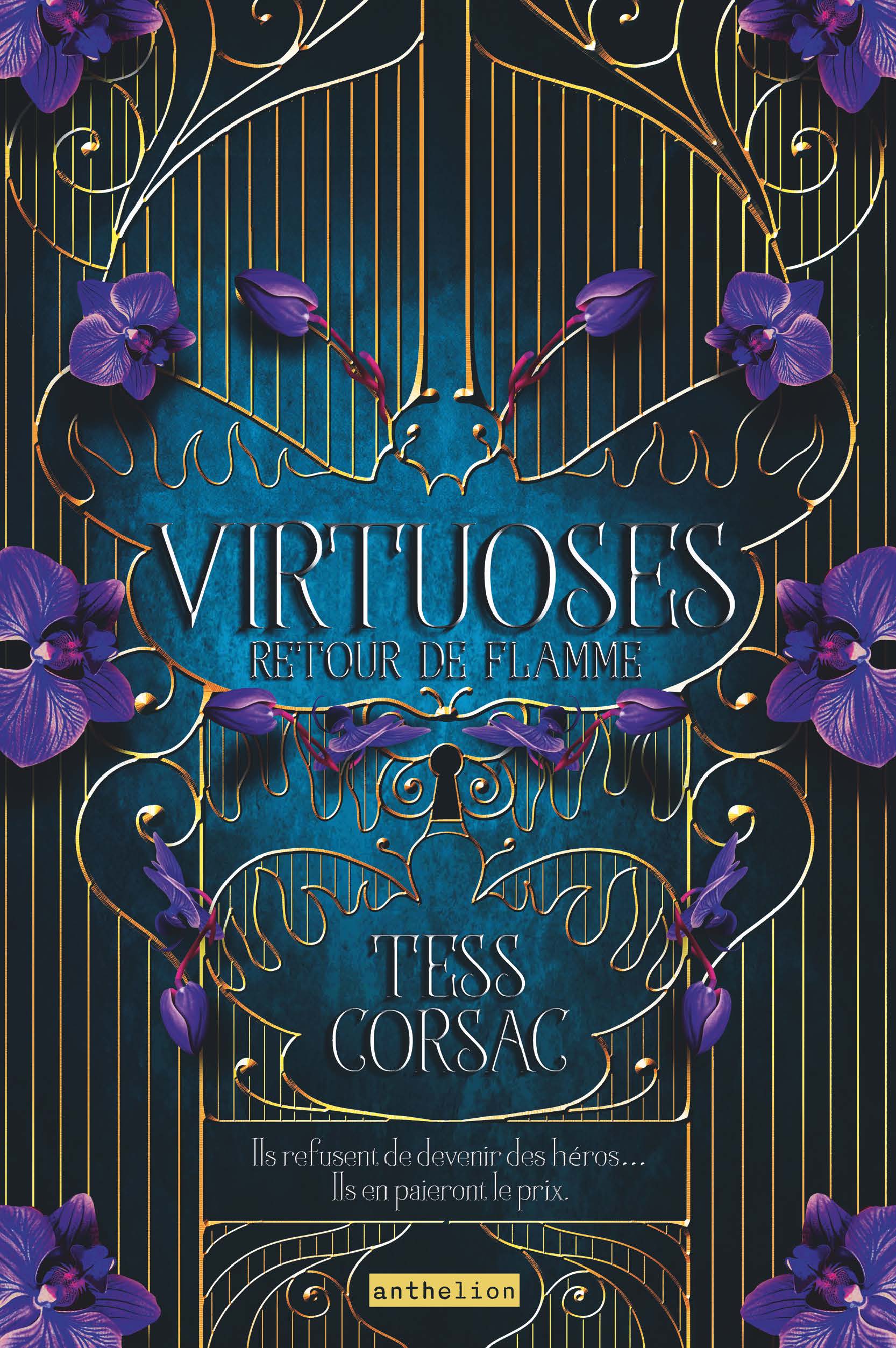Delphine Bertholon
Quand revient la nuit

-
Delphine Bertholon
Albin Michel Jeunesse
01/02/2019
250 p., 14.90 €
-
L'entretien par
Gaëlle Farre
Librairie Maupetit (Marseille) -
Lu & conseillé par
7 libraire(s)- Gaëlle Farre de Maupetit (Marseille)
- Enrica Foures de Lafolye & La Sadel (Vannes)
- Mélanie Mignot de Le Grand Cercle (Éragny-sur-Oise)
- Muriel André de École Gabriel Péri (Saint-Chamas)
- Valérie Fèvre de La Cabane à lire (Bruz)
- Christine Thonier de Médiathèque Michel Bezian (Gujan-Mestras)
- Caroline Ménoury de Coiffard (Nantes)
Après un premier texte jeunesse paru en 2016, Ma Vie en noir et blanc (Rageot), Delphine Bertholon, qui est aussi une auteure fort appréciée en littérature générale, revient en ce début d’année avec un roman des plus enthousiasmants à destination des adolescents, Celle qui marche la nuit. Rencontre.
Malo, 15 ans, et sa famille viennent d’arriver dans la campagne gardoise. Après Paris, le choc est rude pour notre héros ! Mais surtout, l’adolescent s’inquiète du fait que sa petite sœur de 5 ans fasse de terribles cauchemars la nuit et qu’elle raconte côtoyer une jeune fille qu’elle est seule à voir. Très vite, Malo va enquêter afin de faire le jour sur les mystères qui entourent la maison que ses parents ont rachetée. Delphine Bertholon mêle habilement le quotidien d’un garçon de 15 ans, un peu perdu dans un nouvel environnement, et une intrigue à mi-chemin entre polar et fantastique. Le rythme est bon et le suspense hautement efficace. Celle qui marche la nuit est un excellent roman !
PAGE — Malo est un héros volontaire, attachant, très proche de sa sœur. On aimerait le connaître ! Comment ce personnage est-il né ? Pouvez-vous nous parler en quelques mots de votre roman à travers lui ?
Delphine Bertholon — Comme Malo, je suis une pure citadine (j’ai grandi à Lyon, je vis à Paris, je rêve de Marseille). À quinze ans, j’aurais donc été mortifiée qu’on m’expédie à la campagne ! Cette idée de « déracinement » d’un petit Parigot m’a servie de point de départ. Le roman raconte la manière dont, grâce à cette enquête sur le passé obscur de la Maison des Pins, l’adolescent va trouver ses marques dans ce nouvel environnement, accepter le changement. J’aime bien les personnages à côté de leurs pompes, sans doute parce que je le suis souvent moi-même ! De fait, Malo est né comme mes héros naissent toujours : je les incarne, à la manière d’une actrice. Je fais corps avec eux, ils deviennent moi et vice-versa, dans un rapport très fusionnel. C’est aussi la raison pour laquelle j’aime tant écrire à la première personne.
P. — Dans Celle qui marche la nuit, et aussi dans Grâce et L’Effet Larsen, on trouve des fantômes et une veine fantastique. En quoi jugez-vous la figure du fantôme intéressante ? Que représente-t-il pour vous ? Croyez-vous aux fantômes ?
D. B. — Pour un scénario, on parle de « fantôme » pour désigner ce qui hante – consciemment ou non – le héros (traumatisme, secret…) : j’aime bien cette notion, que je trouve psychologiquement très juste. Malo possède son propre fantôme, c’est-à-dire la mort prématurée de sa mère. J’aime aussi l’idée que les lieux ont une mémoire qui peut influer sur les gens (il arrive de se sentir mal quelque part, sans raison rationnelle). À l’inverse, nous projetons parfois sur les lieux nos émotions, positives ou négatives. Dans L’Effet Larsen, Nola est en deuil et ressent donc son nouvel immeuble comme hostile (elle l’appelle « l’immeuble-mutant »). De même, Malo projette sur la Maison des Pins sa frustration et sa tristesse. Mais l’avantage, avec un roman jeunesse, c’est que j’ai pu assumer un véritable fantôme, aller vraiment dans le fantastique, ce que je n’avais encore jamais osé faire. Dans la vie réelle, je ne crois pas aux fantômes… mais je crois que nous vivons tous avec : ils sont nos souffrances passées, mais aussi nos disparus, les gens que nous avons aimés et que nous gardons vivants dans notre cœur, notre mémoire. De ce point de vue, le film Coco me semble très réussi.
P. — Il y a dans Celle qui marche la nuit des références aux Goonies, à Stephen King, une ambiance à la Stranger Things. Quelle pop culture avez-vous ? Regardez-vous des séries ? Et si oui, cela vous influence-t-il ?
D. B. — J’ai toujours regardé des séries (ce qui ne m’a jamais empêchée de lire énormément). Je suis de cette génération « élevée » avec Shérif fais-moi peur, K2000 et MacGyver ! Puis Lynch est arrivé avec Twin Peaks : il a révolutionné le genre et ouvert la voie aux séries telles que nous les connaissons aujourd’hui, lesquelles rivalisent souvent, par leur qualité, avec le cinéma. Cinéphilie et « sériphilie » ont bien sûr une influence sur ma manière de construire mes histoires, avec un souci d’efficacité narrative et un côté très visuel. Si je connais mal, je dois l’avouer, la littérature fantastique, je connais bien ce cinéma-là et je suis une grande fan de films d’horreur. Je les vois tous, même les navets : une vraie addiction !
P. — Vous êtes connue pour vos romans en littérature générale et Celle qui marche la nuit est votre deuxième en littérature jeunesse. Y prenez-vous plaisir ? Écrivez-vous différemment, distinguez-vous vos publics quand vous écrivez ?
D. B. — Mes livres plaisent souvent aux jeunes (à partir de 15-16 ans). Ayant mis en scène de nombreux personnages d’adolescents, je n’ai pas la sensation de travailler différemment. Je crois – enfin, j’espère ! – que Celle qui marche la nuit plaira aussi aux adultes. Il ressemble finalement beaucoup à mes romans pour les « grands » ! J’ai même la sensation qu’il en est une sorte de synthèse tant on y retrouve mes thèmes de prédilection : l’enfance blessée, la solitude, l’enfermement, le secret de famille… Simplement, j’ai tendance à mettre davantage d’humour et à jouer avec des dialogues plus naturalistes ; la principale différence tenant peut-être à l’attention accrue que je porte à véhiculer le juste « message », d’un point de vue moral. Sans me censurer pour autant. Le fond de l’histoire de Celle qui marche la nuit est d’ailleurs assez tordu !