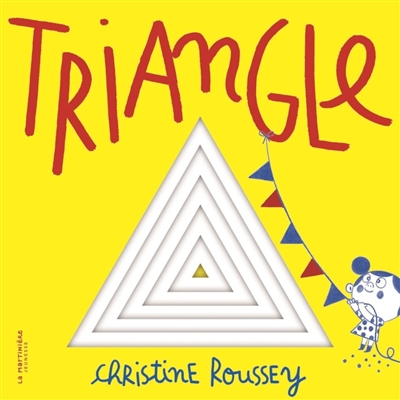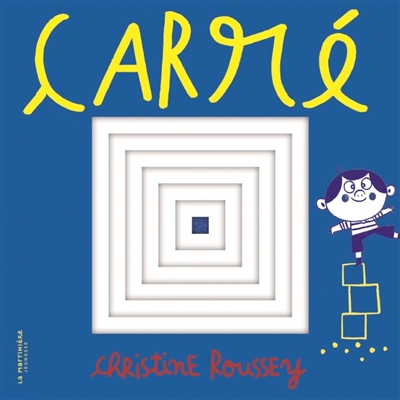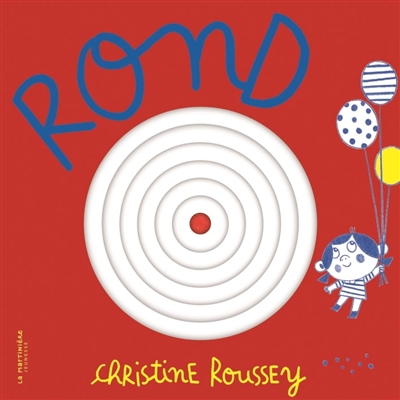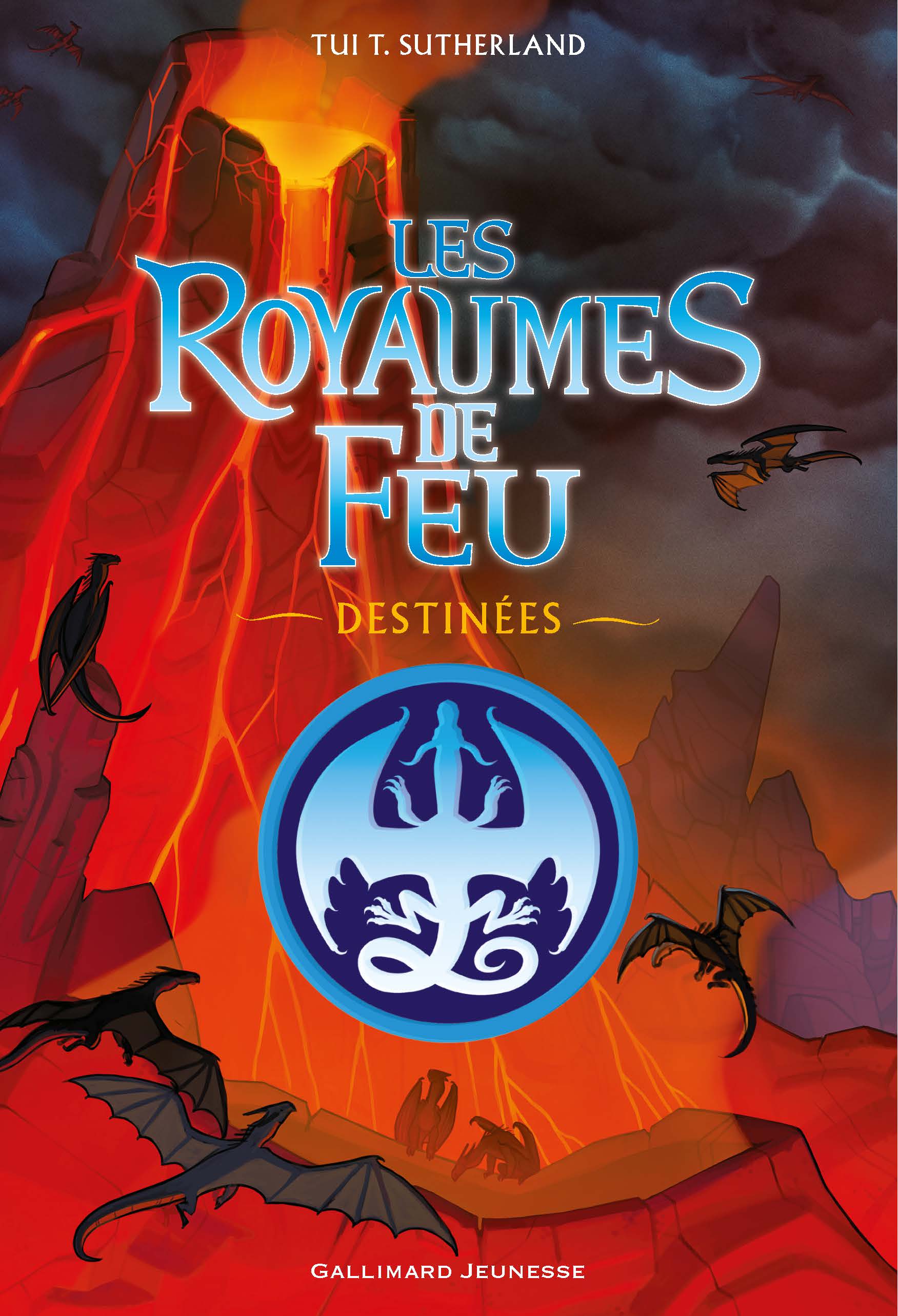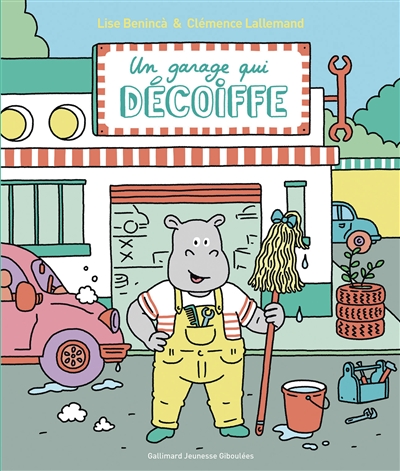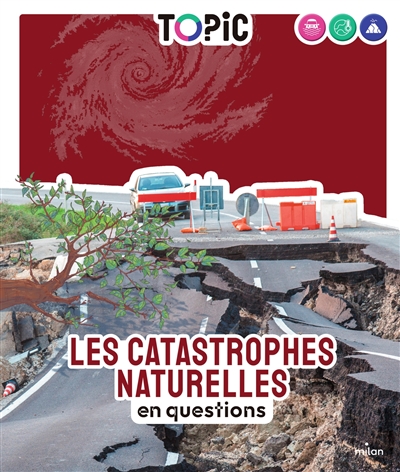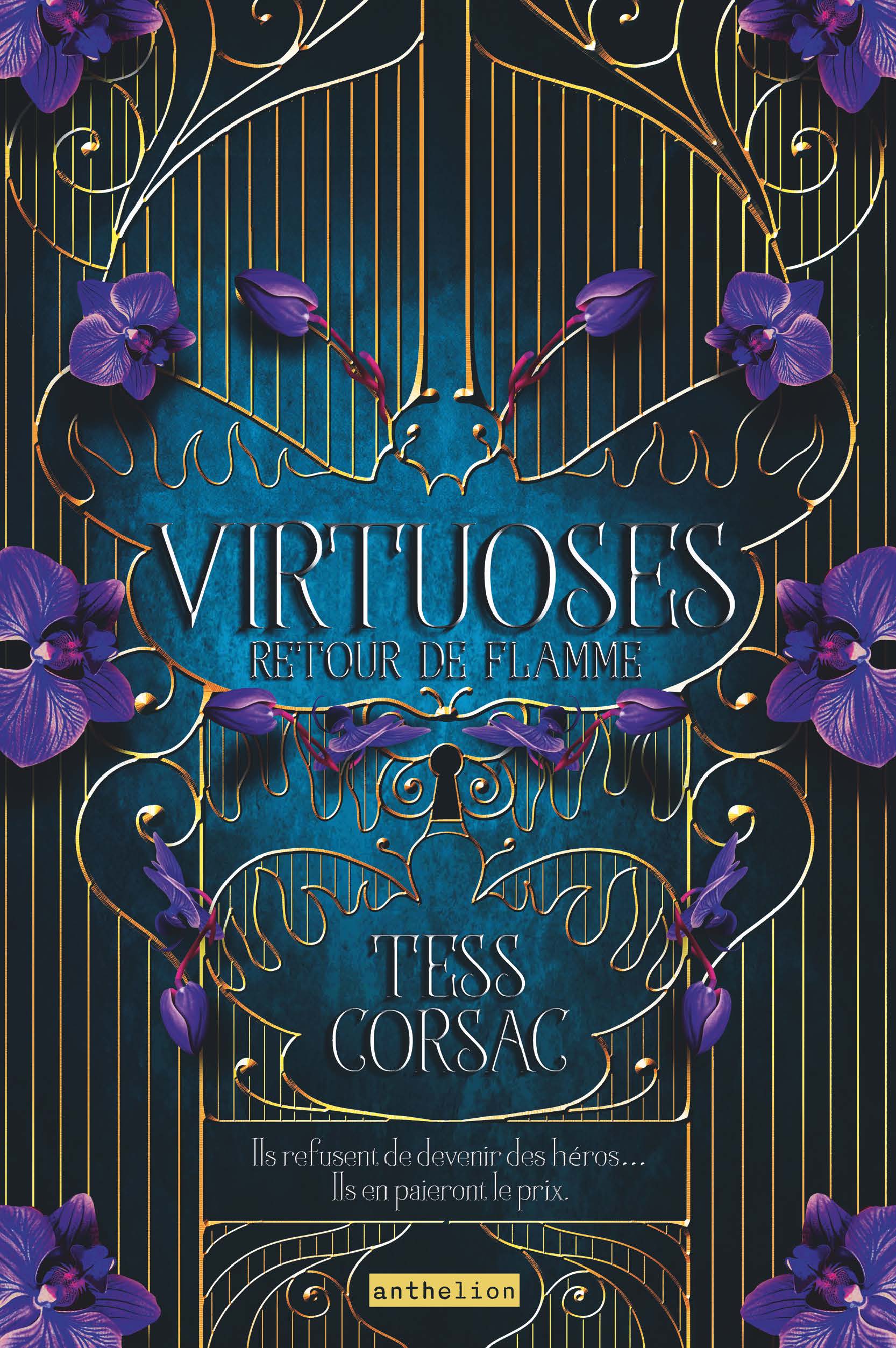Patrick Bard
Sous influence

-
Partrick Bard
Syros
25/08/2016
208 p., 14.95 €
-
L'entretien par
Isabelle Réty
Librairie Gwalarn (Lannion) -
Lu & conseillé par
7 libraire(s)- Isabelle Réty de Gwalarn (Lannion)
- Claire Couthenx de KUBE (MONTROUGE)
- Enrica Foures de Lafolye & La Sadel (Vannes)
- Sophie Martineau de Agora (La Roche-sur-Yon)
- Mélanie Mignot de Le Grand Cercle (Éragny-sur-Oise)
- Céline Vignon de Mots et Images (Guingamp)
- Romain Chiflet de Masséna (Nice)
Écrivain voyageur, photo-journaliste, Patrick Bard raconte dans son dernier roman l’histoire d’une jeune française radicalisée, embrigadée par Daesh sur Internet, et revenant en France après quelques mois passés en Syrie.
Maëlle a 16 ans. Elle habite la banlieue du Mans et mène l’existence ordinaire d’une adolescente de son âge. Cette année, pourtant, sa vie va être complètement bouleversée. Elle passe de plus en plus de temps sur Internet, sur Facebook, et modifie son comportement. Elle abandonne le sport, quitte son petit copain, adhère aux thèses du complot et tient des discours de plus en plus radicaux. Victime d’un rapt mental, rien ne l’empêchera de partir en Syrie pour ce qu’elle pense être une mission humanitaire. C’est une jeune femme mariée et enceinte qui reviendra en France un an plus tard. Maëlle, devenue Ayat, est assignée à résidence et doit subir un long processus de déradicalisation. Mais comment reprendre le cours de sa vie après un épisode aussi traumatisant ? Sur un sujet brûlant d’actualité, Et mes yeux se sont fermés est un formidable et bouleversant roman d’une incroyable sobriété, qui jamais ne verse dans le sensationnel ou le larmoyant. À mettre entre toutes les mains.
Dans votre roman, vous racontez le parcours d’une jeune fille, Maëlle, qui revient de Syrie. Comment écrit-on à chaud une fiction sur un thème d’actualité aussi grave ?
Patrick Bard — Je ne l’aurais pas écrite, je crois, si cela n’avait pas été à chaud. Le 7 janvier 2015, j’ai perdu un ami, Michel Renault, dans les locaux de Charlie Hebdo. Je connaissais aussi Tignous, qui était venu à la maison. La même semaine, j’ai appris que le fils d’une amie de ma fille, qui n’avait rien à voir avec la culture musulmane, était parti faire le jihad en Syrie après avoir été embrigadé via Internet. Le télescopage entre ces deux informations m’a fait comprendre qu’éventuellement, jihadistes et victimes d’attentats pouvaient venir du même milieu social. Ceux-là auraient très bien pu se croiser chez moi, s’asseoir à la même table et partager un repas. J’ai alors pris conscience qu’il n’y avait pas un modèle de jihadiste type, mais autant de modèles que d’individus, de trajectoires, et que le portrait-robot alors véhiculé par les médias, à savoir les cités, les prisons qui fabriquent des jihadistes, était pour partie un stéréotype qui ne correspondait pas nécessairement, ou plus totalement, à la réalité. Je me suis dit que le roman était une réponse.
Pourquoi avoir fait le choix d’une héroïne alors que l’on parle principalement de jeunes garçons qui partent en Syrie ?
P. B. — Parce que, d’une manière générale, les femmes sont au cœur de mon travail d’écrivain. Et parce que, justement, on ne parle pas beaucoup des filles, dont très peu sont revenues. Je me suis interrogé sur leurs motivations. Sur ce qui les poussait à partir : un sentiment d’injustice, la perspective de l’aventure liée à une expérience de vie éthique, de leur point de vue, évidemment. Celles qui sont parties ne sont pas stupides. La plupart du temps, elles voulaient travailler dans l’humanitaire. C’est par là que les recruteurs les séduisent. Par la soif d’équité, la volonté de changer le monde. C’est une chose sur laquelle les femmes n’ont rien à envier aux hommes. Par ailleurs, d’un point de vue plus technique, je trouvais que le roman choral, qui était une forme que j’avais envie d’expérimenter, se prêtait mieux à un personnage féminin.
Vous avez publié plusieurs romans en littérature adulte sur des thèmes militants, tels que l’exil ou encore les trafics d’enfants. Pourquoi vous adressez-vous cette fois-ci directement aux adolescents ?
P. B. — Je ne savais pas, et je ne suis toujours pas certain de savoir ce qu’est un roman jeunesse. Sinon qu’ici, les personnages principaux sont des adolescents. Je me suis rappelé, au moment des attentats de Charlie, que quelques années plus tôt, dans un collège de Lozère où j’animais un atelier d’écriture, deux gamins de 5e avaient levé la main pour dire : « Nous, plus tard, on veut être martyrs ! » Ça, plus ce fils d’amie parti en Syrie, j’ai pensé que cette fois, je voulais raconter une histoire à ceux qui étaient en âge d’être embrigadés. Même s’ils ne le voient pas comme un embrigadement. Ils sont en but à la théorie du complot, un thème que je voulais également aborder. C’est difficile d’accepter que le monde soit un chaos. Nous avons tous tendance à chercher un sens caché, un ordre souterrain aux choses, à désigner des coupables. Les idéologies totalitaires fournissent toutes les réponses.
Vous êtes écrivain, voyageur et photojournaliste. Avez-vous eu l’opportunité de rencontrer un ou plusieurs adolescents partis faire le jihad en Syrie ?
P. B. — Non. Je connais le Liban, la frontière syrienne, le sud de la Turquie, mais je ne suis pas allé à Raqqa. Par contre, pour mon enquête, j’ai parlé à des parents d’enfants embrigadés ou convertis, pas nécessairement par Daesh, d’ailleurs, mais par les salafistes en général. Des étudiants en chant lyrique, en cuisine, des enfants d’enseignant, de restaurateur d’art, de directeur d’agence photo, d’informaticien. J’ai compris que toutes les classes sociales étaient potentiellement vulnérables, que ce n’était pas une question spécifiquement liée à l’immigration. J’ai aussi compris que cette question de l’embrigadement en disait autant sur nos sociétés et leur vacuité, que sur la barbarie de Daesh. À ce propos, ne jamais oublier la phrase de Lévi-Strauss : « Le barbare, c’est celui qui croit à la barbarie ». J’ai aussi beaucoup fréquenté les sites jihadistes et les pages de convertis, les tutoriels pour nouer son hijab, coudre son jilbab, etc. Le web est glaçant. À un moment, une amie m’a parlé d’une copine dont la fille était en train de se radicaliser et, à mon grand effroi, elle m’a décrit des scènes que j’étais en train de raconter quasiment mot pour mot. J’ai mesuré à quel point j’étais proche de la réalité.